Newsletter du DPP : Quand la loi parle le langage de la culture
- A.M.O.

- 4 nov. 2025
- 3 min de lecture
Le Bureau du Director of Public Prosecutions (DPP) a publié son édition d’octobre 2025 de la newsletter intitulée The Protection of Our Culture. Une publication dense et éclairante qui montre comment le droit et la culture se rencontrent pour défendre l’identité mauricienne.

Dans son éditorial, Nataraj J. Muneesamy, Assistant DPP et rédacteur en chef, ouvre la réflexion avec une phrase qui résonne : “Harming or destroying Culture are real attacks – not just against one person but against vast communities.” (Porter atteinte ou détruire la culture, c’est attaquer non pas un individu, mais une communauté entière.)
La culture, rappelle-t-il, est à la fois tangible et intangible : monuments, œuvres d’art, musique, rituels, traditions… Elle appartient à tous et non à quelques privilégiés. Les artistes y jouent un rôle essentiel, bien que leur contribution reste souvent sous-estimée, et en particulier celle des femmes artistes, trop souvent exposées à la précarité ou au harcèlement.
Dans son article Expressions of Traditional Culture and Folklore under the Copyright Act 2014, le State Counsel Yanish Jeerasoo explore les limites de la protection juridique des expressions culturelles traditionnelles et du folklore à Maurice. Il rappelle que la Loi sur le droit d’auteur de 2014 reconnaît ces expressions, mais sans leur accorder de statut juridique spécifique. Or, dans une société multiculturelle comme la nôtre, où le séga, les contes, les rituels ou l’artisanat sont souvent issus d’une création collective, l’absence d’auteur identifiable rend leur protection difficile.
Cette réflexion prend tout son sens à l’heure où le patrimoine immatériel risque d’être commercialisé ou détourné sans reconnaissance de ses origines. Le défi, pour Maurice, est de trouver un équilibre entre droits collectifs et liberté créative individuelle, afin de préserver un héritage commun tout en soutenant la création contemporaine.
L’article Protecting Culture through Law: Intellectual Property Rights of Artists de Rajeenee Segobin-Kalachand aborde la question de la propriété intellectuelle et du rôle du droit dans la sauvegarde de la création artistique. L’auteur rappelle que l’art et la culture sont indissociables : le séga mauricien, reconnu par l’UNESCO, en est un symbole vivant. Mais dans un monde numérique dominé par la reproduction et l’intelligence artificielle, les droits des artistes sont plus fragiles que jamais.
La loi mauricienne accorde aux créateurs deux catégories de droits : Les droits économiques, leur permettant de contrôler l’exploitation commerciale de leurs œuvres ; et des droits moraux, garantissant le respect, l’intégrité et la paternité de leurs créations. Ces droits s’étendent jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur, conformément à la Convention de Berne. Cependant, les défis persistent : piratage, utilisation non autorisée d’images ou de musiques, et création d’œuvres dérivées par IA. Les solutions proposées sont de renforcer la sensibilisation à la propriété intellectuelle, moderniser les institutions comme la MASA, et protéger les expressions culturelles traditionnelles au nom des communautés qui les portent.
Dans Beyond the Sound and Beat: How Local Music in Mauritius is Protected?, la conseillère d’État Hansinee Devi Purseed plonge au cœur du paysage musical mauricien. Le séga, les chants bhojpuri, la musique carnatique et les nouveaux genres comme le rap mauricien composent un paysage sonore riche et vivant. Mais dans un monde où une chanson circule de WhatsApp à YouTube en quelques secondes, chaque artiste a besoin de garanties. La Copyright Act 2014 et la MASA (Mauritius Society of Authors) constituent les deux piliers de cette protection. Elles assurent la reconnaissance des droits des musiciens, sanctionnent les infractions et encadrent la gestion des redevances.
L’article appelle aussi à une meilleure coopération entre les autorités et les fournisseurs Internet pour lutter contre le piratage musical en ligne, à l’image du modèle britannique. Enfin, il souligne l’importance d’une éducation au droit d’auteur dès l’école, pour former une génération d’artistes conscients de leurs droits.
L’artiste et écrivaine Mélanie Pérès, invitée de ce numéro, partage son expérience et son regard sur la place des femmes dans le milieu artistique. Elle dénonce les inégalités persistantes, le harcèlement et le manque de structures adaptées aux mères artistes. Elle plaide pour la mise en place d’un code d’éthique artistique, d’un accompagnement psychologique et d’une digitalisation de la MASA afin de moderniser la gestion des droits d’auteur et de mieux protéger les créatrices.
Cette édition du DPP ne se limite pas à des analyses juridiques : elle propose une véritable vision de société. Elle montre que la loi n’est pas un obstacle à la culture, mais une alliée, un outil de transmission et de réinvention. De la protection des artistes à la reconnaissance des patrimoines collectifs, chaque article de The Protection of Our Culture rappelle une vérité simple : Enn nasion ki respekte so kiltir, respekte so pep.








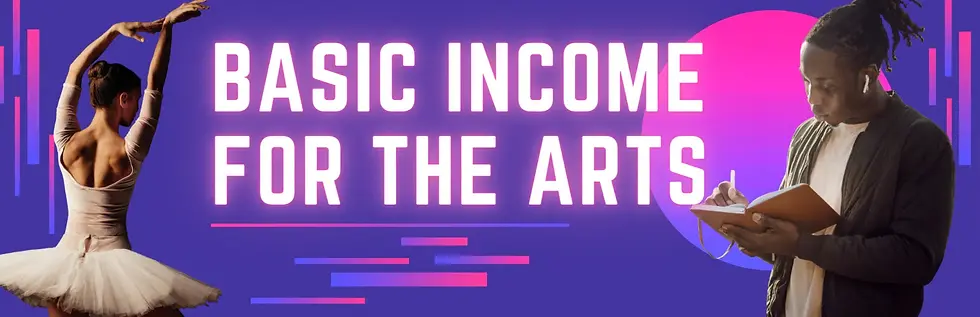


Commentaires